Voici une critique éclairée du livre passionnant de Ruchir Sharma que je vous invite à lire.
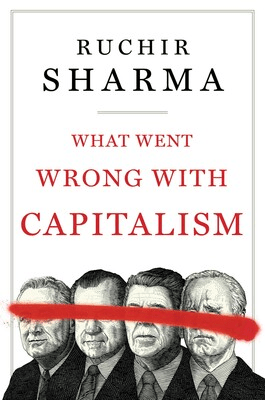
PRIX LISTE 30,00 $
J’envisageais de la faire moi même mais Roberts l’a faite avant moi et il se situe plus ou moins dans le même cadre d’analyse critique que moi, donc je la reproduis.
Roberts conclut en suggérant qu’au des dysfonctionnements du capitalisme, il préfère le socialisme.
Je diverge d’avec lui dans cette conclusion malgré mon analyse sérère de l’évolution du régime capitalise qui rejoint la sienne.
C’est vrai le capitalisme vieillit mal il est devenu pervers, sénile, dangereux , immoral , illégitime et je suis d’accord mais il y a un grand « mais » ; rien ne dit que le socialisme fonctionnerait mieux!
Les exemples du socialisme réel n’ont pas été beaucoup plus satisfaisant.
D’une façon ou d’une autre je ne crois à aucun constructivisme.
C’est le système qui commande, les hommes ne font que tenir des discours sur des réalités qui radicalement leur échappent. Les plus malins montent au sommet en faisant croire qu’ils sont des chefs alors qu’ils ne font que jouer le rôle de tenants lieux narcissiques et prétentieux pour jouir des honneurs, de l’admiration des sots et satisfaire leurs médiocres volontés de puissance. Le système évolue objectivement en fonction de ses contradictions internes et externes et avec, de temps autre, un peu de hasard, c’est tout. Celui qui a tout dit c’est l’ancien patron de Goldman Sachs, Blankfein, il a dit « j’accomplis l’œuvre de Dieu »; le Dieu dont il parle est inconscient, c’est le Système.
Le problème de la sélection des élites, de leur contrôle, de leurs sanctions, n’est pas mieux résolu dans le socialisme que dans le capitalisme; les détenteurs du pouvoir changent de nom mais concrètement et objectivement, ils se comportent toujours de la même façon, même si c’est au nom d’autres principes ou d’autres idéologies/idiologies.
Une Nomenklatura socialiste n’est pas très différentes de la classe des kleptocrates que nous subissons maintenant.
La question de la direction et du gouvernement des masses est centrale et non résolue. Le fait de les choisir choisir autrement ne garantit rien. La question du pouvoir, de la sagesse , du dévouement, de la sainteté de ceux qui l’exercent reste entière ..L’Homme est ce qu’il est!
Quand à celle du gouvernement direct par les soviets, j’attendrai un peu avant d’y croire!
Traduction rapide Bruno Bertez
Sharma a publié un livre intitulé Qu’est-ce qui a mal tourné avec le capitalisme ?Ruchir Sharma est investisseur, auteur, gestionnaire de fonds et chroniqueur pour le Financial Times . Il est à la tête des activités internationales de Rockefeller Capital Management et a été investisseur sur les marchés émergents chez Morgan Stanley Investment Management.
Ayant la réputation d’être « à l’intérieur de la bête » ou même « l’une des bêtes », il devrait connaître la réponse à sa question.
Dans une critique de son livre dans le Financial Times , Sharma expose son argument. Premièrement, il nous dit : « Je m’inquiète de la position actuelle des États-Unis dans le monde. La confiance dans le capitalisme américain, construit sur un gouvernement limité laissant place à la liberté et à l’initiative individuelles, s’est effondrée.» Il note que désormais, la plupart des Américains ne s’attendent pas à être « dans une meilleure situation dans cinq ans » – un niveau record depuis que le baromètre Edelman Trust a posé cette question pour la première fois il y a plus de deux décennies. Quatre personnes sur cinq doutent que la vie soit meilleure pour la génération de leurs enfants qu’elle ne l’a été pour la leur, ce qui représente également un nouveau plus bas. Et selon les derniers sondages Pew, le soutien au capitalisme a chuté parmi tous les Américains, en particulier parmi les démocrates et les jeunes. En fait, parmi les démocrates de moins de 30 ans, 58 pour cent ont désormais une « impression positive » du socialisme ; seuls 29 pour cent disent la même chose du capitalisme.
C’est une mauvaise nouvelle pour Sharma, fervent partisan du capitalisme. Qu’est-ce qui ne va pas ? Sharma dit que c’est la montée d’un grand gouvernement, d’un pouvoir monopolistique et de l’argent facile pour renflouer les grands. Cela a conduit à la stagnation, à une faible croissance de la productivité et à une augmentation des inégalités.
Sharma soutient que la soi-disant révolution néolibérale des années 1980, censée remplacer la gestion macroéconomique de type keynésien, réduire la taille de l’État et déréglementer les marchés, était en réalité un mythe. Sharma : « L’ère du petit gouvernement n’a jamais eu lieu. » Sharma souligne qu’aux États-Unis, les dépenses publiques ont été multipliées par huit depuis 1930, passant de moins de 4 pour cent à 24 pour cent du PIB – et 36 pour cent en incluant les dépenses des États et locales. Parallèlement aux réductions d’impôts, les déficits publics se sont creusés et la dette publique a explosé.
Quant à la déréglementation, le résultat a en réalité été « des règles plus complexes et plus coûteuses, pour lesquelles les riches et les puissants étaient les mieux équipés ». Les règles réglementaires se sont en fait accrues. Quant à l’argent facile, « craignant que l’augmentation des dettes ne se termine par une nouvelle dépression semblable à celle des années 1930, les banques centrales ont commencé à travailler aux côtés des gouvernements pour soutenir les grandes entreprises, les banques, et même les pays étrangers, à chaque fois que les marchés financiers vacillaient ». Il n’y a donc pas eu de transformation néolibérale permettant au capitalisme de se développer, bien au contraire.
Mais l’histoire économique de Sharma après les années 1980 est-elle vraiment exacte ? Sharma tente de décrire la période post-1980 comme une période de sauvetage des banques et des entreprises pendant les crises, contrairement aux années 1930, lorsque les banques centrales et les gouvernements suivaient une politique de « liquidation » de ceux qui étaient en difficulté. En réalité, ce n’est pas exact : l’épargne du capital des entreprises et des banques a été la force motrice du New Deal de Roosevelt ; la liquidation n’a jamais été adoptée comme politique gouvernementale. De plus, les années 1980 ont été pour l’essentiel une décennie de taux d’intérêt élevés et de politiques monétaires strictes imposées par des banquiers centraux comme Volcker, cherchant à faire baisser l’inflation des années 1970. En effet, Sharma n’a rien à dire sur la « stagflation » des années 1970 – une décennie, selon lui, où le capitalisme avait un petit gouvernement et une faible réglementation.
Sharma fait grand cas de l’augmentation des dépenses publiques, y compris des « dépenses sociales », au cours des 40 dernières années. Mais il n’explique pas vraiment pourquoi. Après l’augmentation des dépenses et de la dette pendant la guerre, une grande partie de l’augmentation des dépenses depuis est due à une augmentation de la population, en particulier une augmentation du nombre de personnes âgées, conduisant à une augmentation des dépenses (improductives pour le capitalisme) en matière de sécurité sociale et de retraites. Mais l’augmentation des dépenses publiques était également une réponse à l’affaiblissement de la croissance économique et de l’investissement dans le capital productif à partir des années 1970. À mesure que le PIB augmentait plus lentement et que les dépenses sociales augmentaient plus rapidement, le rapport dépenses publiques /PIB augmentait.
Sharma ne dit rien des autres aspects de la période néolibérale. La privatisation était une politique clé des années Reagan et Thatcher. Les actifs de l’État ont été vendus pour accroître la rentabilité du secteur privé. En ce sens, il y a eu une réduction du « grand État », contrairement à l’argument de Sharma. En effet, dès le milieu des années 1970, le stock de capital du secteur public a été liquidé. Aux États-Unis, sa part du PIB a été réduite de moitié.

Source : Base de données du FMI sur les investissements et le stock de capital, 2021
De même, depuis les années 1980, la part des investissements du secteur public dans le PIB a été réduite de près de moitié, tandis que celle du secteur privé a augmenté de 70 %.

Ce n’est pas le « grand État » qui contrôle les décisions d’investissement et de production, c’est le secteur capitaliste. Cela donne une idée de la raison pour laquelle le rôle du secteur public est réduit. Le problème du capitalisme à la fin des années 1960 et dans les années 1970 était la chute drastique de la rentabilité du capital dans les principales économies capitalistes avancées. Il fallait inverser cette chute. L’une des politiques était la privatisation. Une autre politique consistait à écraser les syndicats au moyen de lois et de réglementations conçues pour rendre difficile, voire impossible, la création de syndicats ou la conduite d’actions revendicatives. Ensuite, il y a eu le déplacement des capacités manufacturières du « Nord » vers les régions de main-d’œuvre bon marché du Sud, ce qu’on appelle la « mondialisation ». Combiné à l’affaiblissement des syndicats dans le pays, le résultat a été une forte baisse de la part du PIB consacrée au travail ainsi qu’à la main-d’œuvre bon marché à l’étranger ; et une (modeste) hausse de la rentabilité du capital.

Sharma admet que « la mondialisation a amené plus de concurrence, limitant l’inflation des prix à la consommation » contre sa thèse de la stagnation des monopoles, mais il soutient ensuite que la mondialisation et la faiblesse des prix des biens importés « ont renforcé la conviction que les déficits et la dette publics n’ont pas d’importance ». Vraiment? Tout au long des années 1990, les gouvernements ont tenté d’imposer « l’austérité » au nom de l’équilibre budgétaire et de la réduction de la dette publique. Ils ont échoué, non pas parce qu’ils pensaient que « les déficits et la dette n’ont pas d’importance », mais parce que la croissance économique et les investissements productifs ont ralenti. Les réductions des dépenses du secteur public ont été significatives, mais leur ratio par rapport au PIB n’a pas diminué.
Sharma estime que « les récessions étaient de plus en plus rares » dans la période post-1980. Hmm. En dehors de l’énorme double crise du début des années 1980 (un autre facteur clé de la baisse de la main-d’œuvre), il y a eu des récessions en 1990-1, 2001, puis la Grande Récession de 2008-2009, culminant avec la crise pandémique de 2020, la pire. effondrement de l’histoire du capitalisme. Peut-être de moins en moins souvent, mais de plus en plus dommageables.
Sharma note qu’après chaque crise depuis les années 1980, l’expansion économique a été de plus en plus faible. Cela apparaît comme un mystère pour les partisans du capitalisme. « Derrière le ralentissement de la reprise se cache le mystère central du capitalisme moderne : un effondrement du taux de croissance de la productivité, ou de la production par travailleur. Au début de la pandémie, il avait diminué de plus de moitié depuis les années 1960. »
Sharma présente son explication : « un nombre croissant de preuves pointent du doigt un environnement commercial chargé de réglementations gouvernementales et de dettes, dans lequel les méga-entreprises prospèrent et de plus en plus de sociétés mortes survivent à chaque crise. » Les plans de sauvetage des grands monopoles (« trois industries américaines sur quatre se sont fossilisées en oligopoles ») et « l’argent facile » ont maintenu un capitalisme stagnant, engendrant des entreprises « zombies » qui ne survivent que grâce à l’emprunt.
Sharma met ici les bœufs avant la charrue. La croissance de la productivité a ralenti dans tous les domaines parce que la croissance des investissements productifs a chuté. Et dans les économies capitalistes, l’investissement productif est motivé par la rentabilité. La tentative néolibérale visant à accroître la rentabilité après la crise de rentabilité des années 1970 n’a été que partiellement couronnée de succès et a pris fin au début du nouveau siècle. La stagnation et la « longue dépression » du 21 ème siècle se manifestent par une augmentation de la dette privée et publique alors que les gouvernements et les entreprises tentent de surmonter la stagnation et la faiblesse de leur rentabilité en augmentant leurs emprunts.

Sharma proclame que « l’immobilité sociale étouffe le rêve américain ». Alors que, dans le passé rose du « capitalisme compétitif », à force de travail acharné et de dynamisme entrepreneurial, on pouvait passer de la misère à la richesse, ce n’est plus possible aujourd’hui. Mais le « rêve américain » a toujours été un mythe . La majorité des milliardaires et des personnes riches aux États-Unis et ailleurs ont hérité de leur richesse et ceux qui sont devenus milliardaires au cours de leur vie ne l’ont pas fait sans des fonds de démarrage importants provenant de leurs parents, etc.
Et permettez-moi d’ajouter que la thèse de Sharma est entièrement basée sur les économies capitalistes avancées du Nord. Il a peu à dire sur le reste du monde, où vivent la plupart des gens. La mobilité sociale a-t-elle été entravée ou n’a jamais existé ? Existe-t-il un grand État avec des dépenses sociales massives dans ces pays ? Existe-t-il de l’argent facile à emprunter pour les entreprises ? Existe-t-il des monopoles nationaux qui évincent la concurrence ? Y a-t-il des plans de sauvetage à gogo ?
Cela nous amène au message principal de Sharma sur ce qui ne va pas avec le capitalisme. Voyez-vous, pour Sharma, le capitalisme tel qu’il l’envisage n’existe plus. Au lieu de cela, le capitalisme compétitif s’est transformé en monopoles soutenus par un grand État. « Le principe du capitalisme, selon lequel un gouvernement limité est une condition nécessaire à la liberté et aux opportunités individuelles, n’a pas été mis en pratique depuis des décennies. »
Le mythe d’un capitalisme compétitif projeté par Sharma ressemble à la thèse de Grace Blakeley dans son récent livre, Vulture Capitalism, où elle affirme que le capitalisme n’a jamais vraiment été une bataille brutale entre capitalistes concurrents pour une part des profits extraits du travail, mais plutôt une économie bien planifiée et bien planifiée, contrôlée par de grands monopoles et soutenue par l’État.
En fait, Sharma et Blakeley s’accordent sur la montée du « capitalisme monopolistique d’État » comme étant la raison des problèmes du capitalisme. Bien entendu, ils diffèrent sur la solution. Blakeley, étant socialiste, veut remplacer le SMC par une planification démocratique et des coopératives de travail. Sharma, étant « l’une des bêtes », veut mettre fin aux monopoles, réduire l’État et restaurer le « capitalisme compétitif » pour suivre sa « voie naturelle » et assurer la prospérité pour tous. Sharma : « Le capitalisme a besoin d’un terrain de jeu sur lequel les petits et les nouveaux ont la possibilité de défier – de détruire de manière créative – les anciennes concentrations de richesse et de pouvoir. »
Vous voyez, les capitalistes, s’ils sont laissés seuls à exploiter la main-d’œuvre, libérés du fardeau des réglementations et du paiement des dépenses sociales, prospéreront naturellement. « Les vraies sciences expliquent la vie comme un cycle de transformation, de cendres en cendres, et pourtant les dirigeants politiques continuent d’écouter les conseillers prétendant qu’ils savent comment générer une croissance constante. Leur excès de confiance doit être contenu avant qu’il ne cause davantage de dégâts. Ainsi, selon Sharma, le capitalisme se portera à nouveau bien si nous laissons les cycles capitalistes d’expansion et de récession se dérouler naturellement et si nous n’essayons pas de les gérer .
« Le capitalisme reste le meilleur espoir du progrès humain, mais seulement s’il dispose de suffisamment de marge de manœuvre. » Eh bien, le capitalisme a eu beaucoup de marge de manœuvre pendant plus de 250 ans, avec ses hauts et ses bas ; ses inégalités croissantes à l’échelle mondiale ; et maintenant sa menace environnementale pour la planète ; et le risque croissant de conflit géopolitique. Il n’est pas étonnant que 58 % des jeunes démocrates américains préféreraient le socialisme
EN PRIME
Un siècle d’expansion gouvernementale a faussé les marchés financiers, alimenté des inégalités massives et endetté l’Amérique.
Le capitalisme n’a pas échoué, il a été ruiné…
Qu’est-ce qui n’allait pas avec le capitalisme ? Le récit de Ruchir Sharma ne ressemble à aucun de ceux que vous avez entendus auparavant. Il dit que les progressistes ont en partie raison lorsqu’ils se moquent du capitalisme moderne en le qualifiant de « socialisme pour les riches ».
Depuis un siècle, les gouvernements se sont développés dans presque tous les domaines mesurables, depuis les dépenses jusqu’à la réglementation et l’ampleur des sauvetages financiers lorsque l’économie vacille. Le résultat est des garanties publiques coûteuses pour tout le monde : des plans de sauvetage pour les riches, des allocations pour la classe moyenne, une aide sociale pour les pauvres.
En vous ramenant au 19ème siècle, Sharma montre à quel point les réflexes du gouvernement ont complètement changé : de la non-intervention à l’action, de faire trop peu pour aider qui que ce soit dans les moments difficiles à essayer aujourd’hui d’empêcher quiconque de souffrir de difficultés économiques. . Échangeant leurs péchés d’omission et d’indifférence contre des excès de dépenses et d’ingérence, les gouvernements des États-Unis à l’Europe et au Japon ont injecté tellement d’argent dans leurs économies que les marchés financiers ne peuvent plus investir efficacement tout ce capital.
Par inadvertance, ils ont alimenté la montée des monopoles, des entreprises « zombies » et des milliardaires. Ils ont rendu le capitalisme moins juste et moins efficace, ce qui ralentit la croissance économique et alimente la colère populaire. La première étape vers une guérison est un diagnostic correct du problème. Le capitalisme a été gravement déformé par l’intervention constante du gouvernement et la propagation incessante d’une culture du sauvetage. Construire un État encore plus grand ne fera que doubler ce qui a ruiné le capitalisme en premier lieu.
Bonsoir M. Bertez
Question: le capitalisme peut-il bien fonctionner lorsque la démocratie dérive en ochlocratie?
Cordialement
J’aimeJ’aime
Bonjour M. Bertez
» Comment voulez vous gouverner un pays où il existe 258 variétés de fromages? »(Charles de Gaulle)
C’était en 1962
Aujourd’hui la France compte environ 1200 variétés de fromages.
« Oh Bonne Mère! Oh Fan de chichourle! » ( en hommage à J.C Gaudin)
Il semble donc que les fromages de la République soient bel et bien capitalistes, avec le résultat que l’on cache car on ne saurait le voir.
Cordialement
J’aimeJ’aime